1956 à 1988
Nos sociétés s’organisent
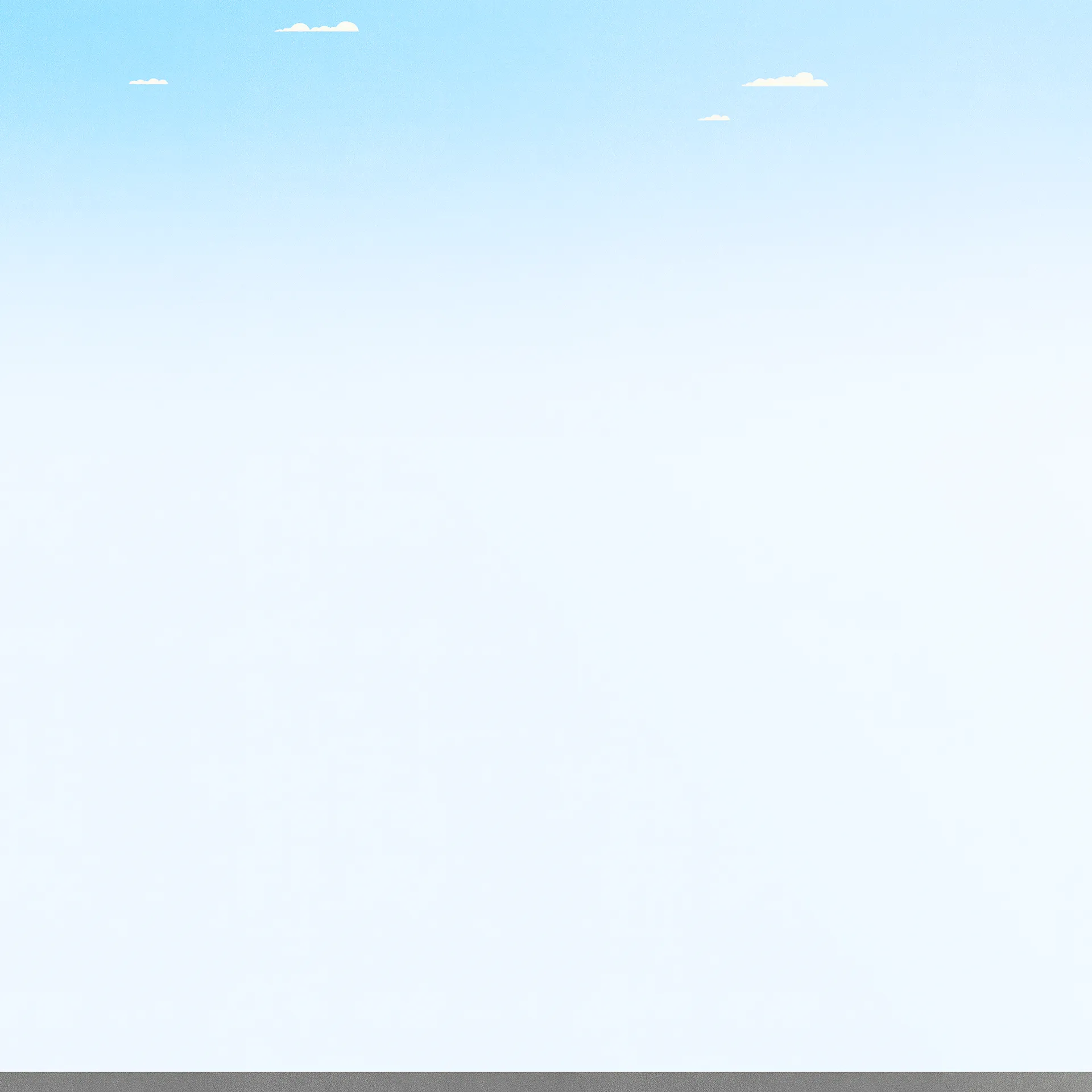
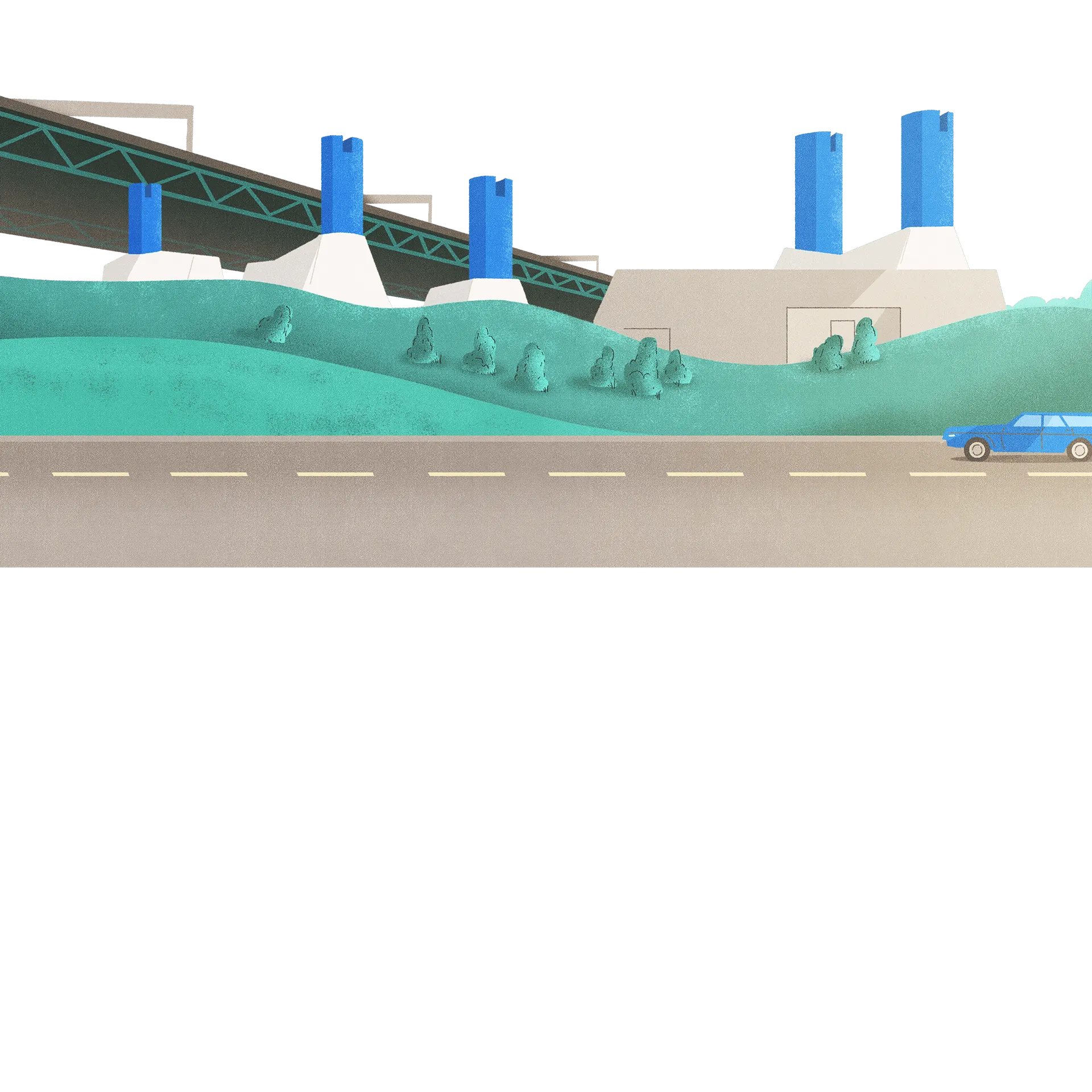
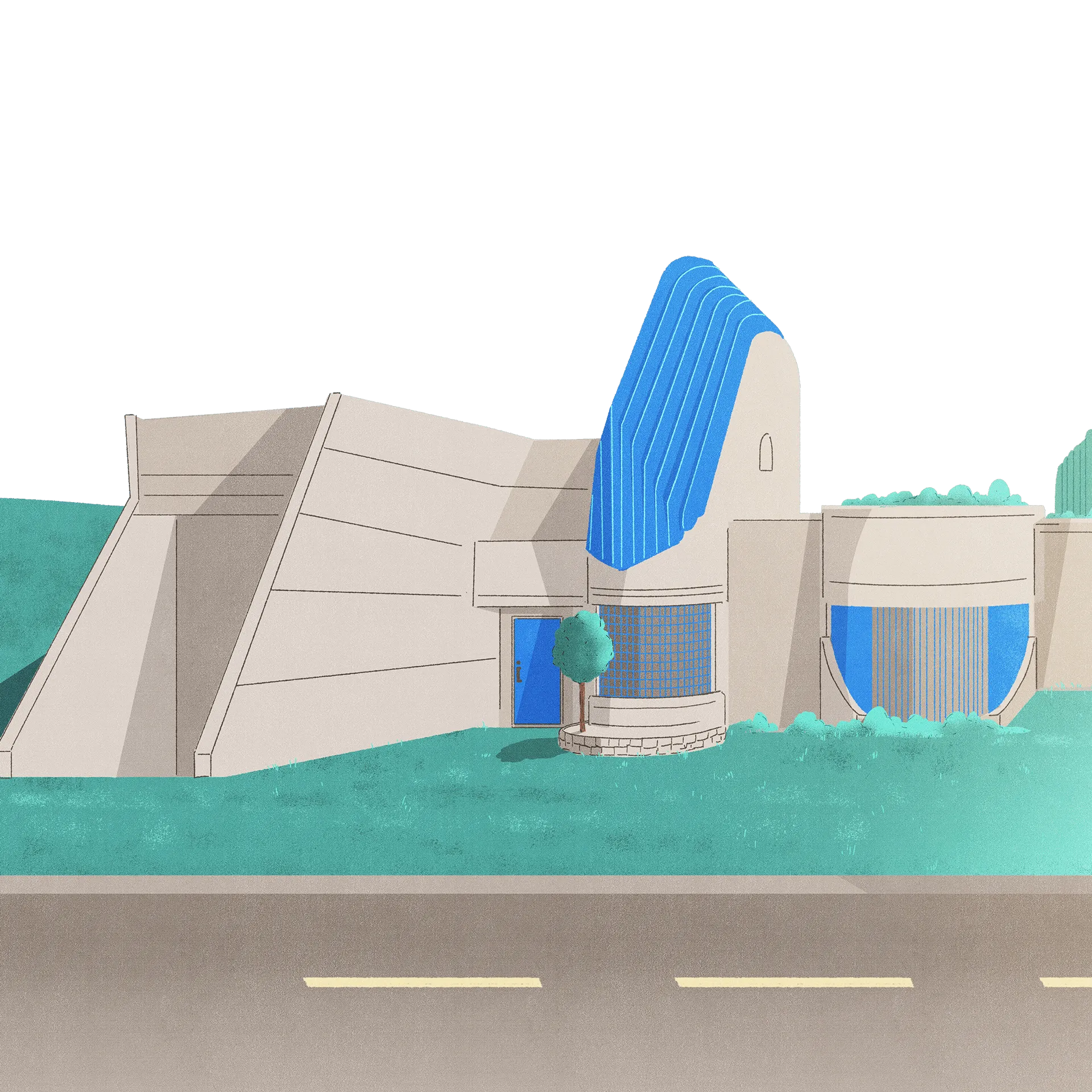

Introduction
Cet élan de collaboration s'étend bien au-delà des réponses immédiates aux crises, jetant les bases d'un avenir où l'innovation et la solidarité régionale façonnent les solutions durables pour l'approvisionnement et le traitement de l'eau.
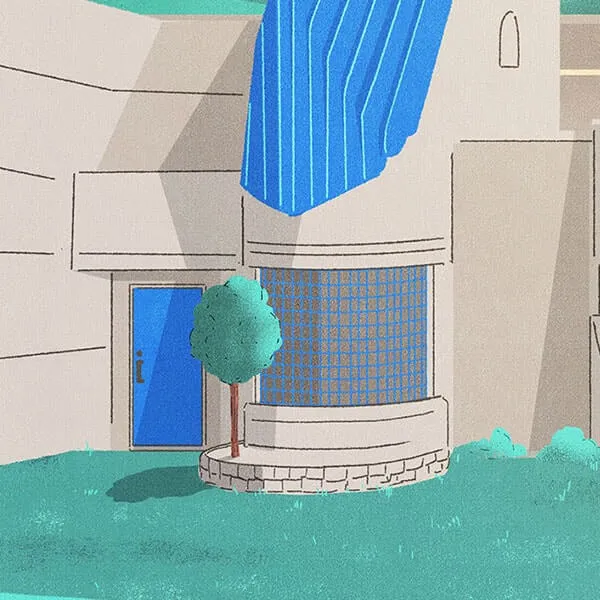
-
Visite de l'usine de filtration de Cité Jacques-Cartier par le Conseil de la Cité de Boucherville, en 1965
-
Visite de l'usine
-
Visite de l'usine
-
Prix AVMSL 1990
-
La station de pompage de l'Administration de la voie maritime du Saint-Laurent (A.V.M.S.L.)
Documents :
L'usine de filtration de Cité de Jacques-Cartier, L'Écho des Monts, 16 mars 1966. Ville de Longueuil. Archives, Fonds de la Ville de Longueuil (1969-2001).
Visiter L'usine de filtration de Cité de Jacques-Cartier, L'Écho des Monts, 16 mars 1966. Ville de Longueuil. Archives, Fonds de la Ville de Longueuil (1969-2001).L'eau au cœur de notre vie, 1986. Ville de Longueuil. Archives, Fonds de la Ville de Longueuil (1969-2001).
Visiter L'eau au cœur de notre vie, 1986. Ville de Longueuil. Archives, Fonds de la Ville de Longueuil (1969-2001).Photos :
Visite de l'usine de filtration de Cité Jacques-Cartier par le Conseil de la Cité de Boucherville, en 1965. Ville de Longueuil. Archives, Fonds de la Ville de Longueuil (1969-2001).
Plaque du premier prix en Architecture 1990 de l'Ordre des architectes du Québec décerné à l'architecte Mario V. Petrone pour la Station de pompage A.V.M.S.L Longueuil. Ville de Longueuil. Archives, Fonds de la Ville de Longueuil (1969-2001).
La station de pompage de l'Administration de la voie maritime du Saint-Laurent (A.V.M.S.L.), 1990. Ville de Longueuil. Archives, Fonds de la Ville de Longueuil (1969-2001).